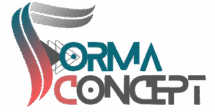Informations pratiques
Toute personne souhaitant exercer le métier de diagnostiqueur immobilier (primo-accédant), ou préparer ses re-certifications
Être capable de…
- réaliser l’ensemble des diagnostics techniques rendus obligatoires par la réglementation : amiante, plomb, termites, gaz, électricité, DPE (Diagnostic de Performance Energétique ; prérequis validé par l’obtention du titre professionnel de niveau 5) ;
- élaborer les diagnostics en utilisant une méthodologie adaptée aux cas traités, en interpréter les résultats et les restituer à un non-spécialiste ;
- proposer des recommandations adaptées aux cas traités, en tenant compte du contexte technique, juridique, économique et environnemental ;
- rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation de la prestation effectuée
- maitriser les bases ainsi que les clés du métier :
- marché du diagnostic immobilier et sa position commerciale, responsabilités et risques juridiques, mécanique de la certification, acteurs de la profession.;
- préparer les examens de certification;
- Obtenir le titre professionnel de niveau 5 de : «Diagnostiqueur Immobilier» (enregistré au RNCP sous le n°35015 par K2D Formarseille – Date d’échéance : 14/10/2025)
238 heures
- Langue française: lu écrit parlé
- Pour le DPE: niveau bac + 2 dans le domaine du bâtiment ou 2 ans d’expérience dans le domaine du bâtiment
Formation dispensée en présentiel, dans nos locaux (20 av. Gabriel Péri – 95870 Bezons)
Délais d’accès :
Modalités d’accès, inscription : dossier d’inscription, et réalisation d’un entretien préalable
- Etudes de cas, analyses, entraînement pratique sur des cas concrets réels
- Remise de livrets stagiaires
- Diaporamas pédagogiques interactifs
- Exercices pratiques d’évaluation
- Examens blancs
- Animation des modules de formation par un formateur certifié et expérimenté dans les domaines du diagnostic immobilier et du bâtiment
- Salle informatique : Ordinateurs, en libre accès dans la salle informatique
- Outillage : Echelle – escabeau – Lampes : torche et frontale (lampe à forte puissance) – Ruban adhésif – Poinçons – tournevis – spatules – Cutter ou outil manuel permettant le prélèvement – Lingettes humidifiées – Bâches – Sacs étanche de grande taille (pour les déchets – bâche – EPI …) – Sachets étanches pour les prélèvements
- EPI : EPI (à usage unique) – gants jetables – sur-chaussures
- Pour l’échantillonage: sacs type congélation zip-loc : pour le double ensachage des échantillons – étiquettes pour identification alpha numérique des échantillons – Fiches de suivi pour envoi au laboratoire
- Évaluation initiale (QCM)
- Évaluation finale (QCM)
- Attestation de formation
- Certifications amiante, plomb, termites, gaz, électricité, DPE (délivrée par un organisme certificateur accrédité par le .COFRAC sous condition de réussite des examens de certification)
- Titre RNCP de « Diagnostiqueur Immobilier », de niveau 5 pour les stagiaires ayant passé les examens préparés dans le cadre du module 7 (enregistré au RNCP sous le n°35015 par K2D Formarseille – Date d’échéance : 14/10/2025)
Possibilité de valider un/ou des blocs de compétence : non
Exercice du métier de diagnostiqueur immobilier
▶︎ Consulter le formacode en ligne
▶︎ Consulter la fiche rome
Equivalences, passerelles : non
7000 € net pour 260 heures de formation (TVA non applicable)
Programme
- Les diagnostics immobiliers : généralités
- Objectifs
- Typologie des diagnostics
- Le rôle du diagnostiqueur immobilier
- Réglementation
- Missions
- Responsabilité
- Les prérequis pour exercer
- Les diagnostics obligatoires
- Diagnostics immobiliers obligatoires à la vente
- Diagnostics immobiliers obligatoires à la location
- Les missions: plomb – Pourquoi ? Rôle du diagnostiqueur ?
- Les missions: amiante – Pourquoi ? Rôle du diagnostiqueur ?
- Les missions: installation intérieure d’électricité – Pourquoi ? Rôle du diagnostiqueur ?
- Les missions: termites – Pourquoi ? Rôle du diagnostiqueur ?
- Les missions: installation intérieure de gaz – Pourquoi ? Rôle du diagnostiqueur ?
- Les missions: DPE – Pourquoi ? Rôle du diagnostiqueur ?
- Les missions: Loi Carrez – Pourquoi ? Rôle du diagnostiqueur ?
- Les missions: état des risques naturels, miniers, et technologiques – Pourquoi ? Rôle du diagnostiqueur ?
- Se diversifier
- Au-delà des diagnostics obligatoires: les domaines de diversification existant
- S’équiper
- Obligations pour chaque diagnostic
- Réglementation
- Obligations légales et réglementaires
- Responsabilité du diagnostiqueur
- Typologie des clients
- Démarrer son activité de diagnostiqueur immobilier
- L’historique
- l’utilisation du plomb et de ses composés dans les bâtiments d’habitation, des techniques d’utilisation du plomb, et notamment dans les peintures.
- L’historique de la réglementation de l’utilisation et de l’interdiction de certains des composés du plomb dans les peintures.
- Les composés du matériau plomb contenu dans les peintures : formes chimiques sous lesquelles le plomb a été utilisé ; propriétés physico-chimiques du plomb et de ses composés ; distinction entre plomb total et plomb acido-soluble.
- Le risque sanitaire
- lié à une exposition au plomb : connaissance des situations et compréhension des mécanismes permettant l’exposition des personnes au plomb dans l’habitation, et notamment des enfants ;
- Conséquences sur la santé de l’exposition au plomb.
- Les dispositifs législatifs et réglementaires actuels relatifs à la protection de la population contre les risques liés à une exposition au plomb dans les immeubles bâtis, à la protection des travailleurs et à l’élimination des déchets contenant du plomb.
- Le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants dans la prévention des risques liés au plomb dans les bâtiments d’habitation.
- Les normes et les méthodes de repérage
- Evaluation de l’état de conservation, de mesure d’empoussièrement au sol et d’examen visuel.
- L’identification et la caractérisation des critères de dégradation du bâti, qui font partie intégrante de l’établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb.
- Contrôle de connaissance
- Entrainement QCM
- Rédaction d’un rapport
Mise en situation pour vérifier si le candidat est capable d’élaborer le diagnostic plomb en utilisant une méthodologie adaptée aux cas traités, à en interpréter les résultats et à les restituer à un non-spécialiste
- Les insectes à larves xylophages
- Capricornes des maisons ; Hespérophanes ; Vrillettes ; Lyctus
- Apports théoriques et reconnaissances des dégâts
- Les insectes nidificateurs
- Sirex ; Abeilles charpentières ; Fourmis
- Apports théoriques et reconnaissances des dégâts
- Les champignons
- Pourriture cubique ; Pourriture fibreuse ; Pourriture molle ; Discoloration
- Apports théoriques et reconnaissances des dégâts
- Les insectes xylophages
- Les termites souterrains. Les termites de bois sec. Biologie. Reproduction. Propagation.
- Reconnaissance des traces et des dégradations. Echantillons de bois dégradés.
- Photothèque et film sur la vie des termites
- Formation et structure des bois
- Composition chimique
- Croissance
- Bio détérioration
- Les feuillus
- Les résineux
- Les bois exotiques
- Le bois dans la construction
- Systèmes constructifs utilisant le bois
- Caractéristiques mécaniques
- Mise en œuvre
- Défauts
- Rôle de l’humidité
- Les traitements
- Préventifs
- Curatifs
- Des bois
- Des sols
- Cadre réglementaire
- Loi
- Décret
- Arrêté
- Norme
- Jurisprudence
- Responsabilité du diagnostiqueur
- Assurance
- Rédaction d’un contrat de mission
- Cadre descriptif
- Présentation d’un document type
- Rédaction d’un état termites
- Cadre descriptif
- Présentation du document conformément à la réglementation
- Conduite d’un diagnostic
- Méthodologie
- Mise en situation
- Outillage et équipements nécessaires au bon déroulement de la mission
- Reconnaissances des dégradations biologiques du bois
- Maitriser le diagnostic en visualisant et comprenant les différents types de pathologies les termites, les insectes à larves xylophage et les champignons
- Contrôle des connaissances
- Travaux pratiques
- Entrainement QCM
12. Rédaction d’un rapport
Jour 1 :
- Les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d’état et la terminologie juridique du bâtiment ;
- le matériau amiante, notamment ses propriétés physico-chimiques et son comportement vis-à-vis des agressions d’origine anthropique et naturelle ;
- les risques sanitaires liés à une exposition aux fibres d’amiante;
- les différents matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ;
- l’historique des techniques d’utilisation de l’amiante et conditions d’emploi des matériaux et produits ayant contenu de l’amiante jusqu’à leur interdiction ;
Jour 2 :
- les dispositifs législatif et réglementaire relatifs à l’interdiction d’utilisation de l’amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et à l’élimination des déchets contenant de l’amiante ;
- le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants ;
- les normes et les méthodes de repérage, d’évaluation de l’état de conservation et de mesure d’empoussièrement dans l’air et d’examen visuel (normes et les méthodes permettant de mettre en œuvre les repérages visés aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 (matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante) du code de la santé publique ; les normes et les méthodes permettant de mettre en œuvre les évaluations visées à l’article R. 1334-27 du code de la santé publique) ;
Jour 3 :
- les règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, notamment dans les établissements recevant du public de catégorie 5 et les immeubles collectifs d’habitation ;
- les techniques de désamiantage, de confinement et des travaux sous confinement ;
- rappel des nouveautés législatives, réglementaires ou normatives ainsi que des évolutions technologiques;
- contrôle des connaissances : entrainements QCM, cas pratiques, rédaction d’un rapport, réalisation de mises en situation.
- Quels types de gaz dans les habitations ?
- Gaz naturel. Sa distribution. Gaz citerne. Stockage en réservoirs fixes. Les réservoirs GPL. Gaz bouteille. Les installations gaz en bouteilles. Installation butane et propane
- Les risques liés à l’utilisation du gaz
- Qu’est-ce qu’un gaz combustible. Comment ce produit la combustion. Les risques d’une mauvaise combustion
- Le monoxyde de carbone
- Définition
- Pourquoi est-il dangereux ?
- Quelques exemples d’intoxication et remèdes
- Fixation du monoxyde de carbone dans le corps
- D’où vient le CO ?
- Effet du CO sur l’être humain en fonction de la durée d’exposition
- Type d’appareil utilisant le gaz dans les logements
- Appareil étanche
- Appareil raccordé
- Appareil non raccordé
- Les installations spécifiques (VMC gaz….)
- L’évacuation des gaz brulés
- Constitution d’une installation intérieur gaz – Tuyauterie fixe
- acier
- cuivre
- plomb
- polyéthylène
- Les organes de coupure
- Les détendeurs
- Les compteurs
- L’alimentation en gaz des appareils (ou raccordement en gaz des appareils)
- Rigide
- Flexible
- Souple
- Les appareils
- cuisson
- chauffage
- chauffe eau
- Aménagement des locaux
- Volume, ouvrant, aérations
- Les protections
- Goulotte
- Fourreau
- Les sécurités
- La sécurité de flamme
- Le SPOTT
- La DSC
- Le contexte réglementaire
- L’arrêté du 02/08/1977, DTU 61.1, Code de la construction et de l’habitation
- La Norme NF P 45-500
- Domaine d’application
- Termes et définitions
- Point de contrôle Rédaction d’un contrat de mission
- Cadre descriptif, Présentation d’un document type
- Rédaction d’un diagnostic gaz
- Cadre descriptif, Présentation du document conformément à la réglementation
- Méthodologie de réalisation d’un diagnostic
- Les différentes étapes du diagnostic
- Identification des points clés à vérifier
Rédaction d’un rapport sur la base d’un exemple commenté
- Les lois générales de l’électricité
- tension, intensité, courant continu, courant alternatif, résistance, puissance, effets du courant électrique sur le corps humain ;
- Les règles fondamentales destinées à assurer la sécurité des personnes contre les dangers et dommages pouvant résulter de l’utilisation normale d’une installation électrique à basse tension : protection contre les chocs électriques et les surintensités, coupure d’urgence, commande et sectionnement, choix du matériel en fonction des conditions d’environnement et de fonctionnement.
- Les méthodes d’essais
- Au moyen d’appareils de mesures et d’essais appropriés, de s’assurer de l’efficacité de la mise en œuvre des règles fondamentales de sécurité : mesure de la valeur de la résistance de la prise de terre, mesure de la résistance de continuité des conducteurs de protection et d’équipotentialité, mesure du seuil de déclenchement des dispositifs différentiels ;
- La technologie des matériels électriques constituant une installation intérieure d’électricité : fusibles, disjoncteurs, fonctions différentielles, interrupteurs, prises de courant, canalisations.
- Les règles relatives à la sécurité
- Propre de l’opérateur et des personnes tierces lors du diagnostic.
- le FD C 16-600
- Maîtriser et mettre en œuvre des prescriptions de sécurité à respecter pour éviter les dangers dus à l’électricité dans l’exécution du diagnostic ;
- Maîtriser les méthodes de diagnostic des installations intérieures d’électricité.
- Etre capable de mettre en œuvre une méthodologie de réalisation des états de l’installation
- intérieure d’électricité et d’utiliser les outils dédiés à l’activité ;
- Domaine d’application
- Termes et définitions
- Point de contrôle
- Rédaction d’un contrat de mission
- Cadre descriptif
- Présentation d’un document type
- Contrôle des connaissances
- Entrainement QCM
- Rédaction d’un rapport
- Mise en situation pour vérifier si le candidat est capable d’élaborer le diagnostic électricité en utilisant une méthodologie adaptée aux cas traités, à en interpréter les résultats et à les restituer à un non-spécialiste
1. Introduction
- Présentation du formateur, des apprenants (tour de table)
- Présentation du déroulement de la formation
- Rappel des prérequis relatifs à la certification
2. Les généralités sur le bâtiment
- la typologie des constructions, les bâtiments, les produits de construction, les principaux systèmes constructifs, les techniques constructives, notamment les différents types de murs, de toiture, de menuiseries, de planchers, de plafonds, leur évolution historique et leurs caractéristiques locales ou tout autre élément permettant d’estimer l’année de construction du bâtiment. Les informations contenues à ce sujet dans la méthode de calcul réglementaire en vigueur ;
- les spécificités des bâtiments construits avant 1948 et des bâtiments utilisant des techniques constructives similaires, notamment en termes de conception architecturale et de caractéristiques hygrothermiques des matériaux ;
- le calcul de la surface d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment ;
- l’analyse des configurations thermiquement défavorables pour les lots présents dans des bâtiments à usage principal d’habitation ;
- l’ensemble des pathologies du bâtiment liées notamment à des mauvais dimensionnements d’installations ou encore à l’humidité dans les logements.
3. La thermique du bâtiment
- la thermique des bâtiments, notamment les notions de thermique d’hiver et d’été, y compris la notion de confort thermique en période estivale, de prévention et de traitement des désordres thermiques ou hygrométriques sur les bâtiments ;
- le diagramme de l’air humide ;
- les grandeurs physiques thermiques, notamment la température, les degrés-heures mensuels, la puissance, les énergies primaire, secondaire et finale, le flux thermique, la résistance thermique, la conductivité thermique, la capacité calorifique, l’inertie thermique, les pouvoirs calorifiques supérieur et inférieur, la notion d’émission de gaz à effet de serre ;
- les différents modes de transfert thermique : conduction, convection (naturelle et forcée), rayonnement ;
- les principes des calculs de déperditions par les parois, par renouvellement d’air et par ponts thermiques ;
- les principes de calcul d’une méthode de calcul réglementaire, les différences pouvant apparaître entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que leurs sources, notamment la présence de scenarii conventionnels.
4. L’enveloppe du bâtiment
- les matériaux de construction, leurs propriétés thermiques et patrimoniales, notamment pour des matériaux locaux ou présentant un faible impact environnemental et leur évolution historique ;
- les défauts d’étanchéité à l’air et de mise en œuvre des isolants ainsi que les sources d’infiltrations d’air parasites ;
- les ponts thermiques associés aux différentes parois selon leur inertie thermique (caractérisation, mesure) ;
- les masques solaires associés aux parois vitrées (caractérisation, mesure) ;
- les procédés permettant de déterminer les caractéristiques de l’enveloppe d’un bâtiment, notamment la composition d’une paroi, y compris la présence et la caractérisation de l’isolation, la surface d’un mur, d’un plancher, d’un plafond, les caractéristiques d’une menuiserie, y compris sa surface et la présence d’un pont thermique ;
- les possibilités d’amélioration énergétique et de réhabilitation thermique de l’enveloppe du bâtiment, y compris les différences entre bâtiment individuel et bâtiment collectif, et leurs impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, ses émissions de gaz à effet de serre et sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment.
5. Les systèmes
- les réseaux de chaleur, les équipements techniques, notamment les principaux équipements individuels ou collectifs de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire utilisant différentes sources d’énergie, y compris des énergies renouvelables et notamment ceux présents dans la méthode de calcul réglementaire en vigueur ;
- les principaux équipements de ventilation : équipements présents dans la méthode de calcul réglementaire en vigueur ;
- les principaux équipements d’éclairage ;
- les chaufferies : fonctionnement, sécurité, performances ;
- les auxiliaires des différents systèmes ;
- les systèmes de production d’eau chaude sanitaire : notions de prévention des risques liés aux légionnelles ;
- l’équilibrage des réseaux de distribution ;
- les principaux équipements individuels ou collectifs utilisés pour contrôler et réguler le climat intérieur;
- les défauts de mise en œuvre des installations et les besoins de maintenance ;
- les technologies innovantes ;
- les notions de rendement des installations de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire ;
- la mise en place d’énergies renouvelables ;
- les principales sources d’énergie, leurs avantages et inconvénient, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre ;
- les possibilités d’amélioration énergétique et de réhabilitation thermique des systèmes et leurs impacts potentiels, notamment sur les consommations en énergie du bâtiment, ses émissions de gaz à effet de serre et sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment ;
- les recommandations d’usage des équipements pour diminuer les factures énergétiques, les recommandations de gestion et d’entretien des équipements ;
- les contraintes techniques d’installation d’un système et les impossibilités éventuelles de recommandation d’installation de certains systèmes ;
- les procédés permettant de déterminer les caractéristiques des installations d’un bâtiment.
6. Les textes réglementaires
- les textes législatifs et réglementaires sur le sujet, ainsi que les ressources documentaires mises à disposition par les services du ministre chargé de la construction, notamment les différentes méthodes d’élaboration des diagnostics, la liste des logiciels arrêtée et pouvant être utilisés ;
- les obligations relatives à l’envoi des diagnostics à l’observatoire géré par l’agence de la transition écologique (ADEME), ainsi que les ressources documentaires à ce sujet mises à disposition par les services de l’ADEME ;
- les textes législatifs et réglementaires faisant référence au diagnostic de performance énergétique, notamment les critères de décence énergétique, de gel de loyer, d’audit énergétique réglementaire ;
- les objectifs français et européens relatifs à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et à la rénovation des bâtiments ;
- les notions juridiques de la propriété dans les bâtiments et les relations légales ou contractuelles entre les propriétaires du bâtiment, les propriétaires des locaux à usage privatif, les occupants, les exploitants et les distributeurs d’énergie ;
- la terminologie technique et juridique du bâtiment, en rapport avec l’ensemble des domaines de connaissance mentionnés
7. Contrôle des connaissances :
- Entrainements QCM
- Corrections détaillées
8. Formation «terrain » (1 journée)
Ce temps de terrain est réalisé dans des bâtiments ou parties de bâtiments réels ou aménagés.
- Visite du site;
- manipulation des outils professionnels;
- collecte de données en situation réelle, par l’intermédiaire notamment de prises de mesures.
- mise en pratique réelle de l’intégralité d’un diagnostic d’un bâtiment ou partie de bâtiment réel ou aménagé, sur la base de l’utilisation des outils du diagnostic (manipulation des unités et grandeurs, utilisation des outils de mesures, collecte de données, observation, saisie dans le logiciel, etc.)
9. Mise en situation: réalisation complète d’un diagnostic de performance énergétique, sur la base d’informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d’un dispositif de simulation d’un bâtiment ou de tout autre biais permettant d’avoir accès aux caractéristiques du logement, pour les cas suivants :
- une maison individuelle ;
- un logement situé dans un bâtiment collectif.
10. Mise en situation : réalisation complète d’un diagnostic de performance énergétique, sur la base d’informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d’un dispositif de simulation d’un bâtiment ou de tout autre biais permettant d’avoir accès aux caractéristiques du logement, pour les cas suivants :
- un logement construit avant 1948 ;
- un logement neuf ;
- un lot à usage autre que d’habitation présent dans un bâtiment à usage principal d’habitation.
11. Rédaction de rapports
12. Mise en situation en conditions d’examens : mise en situation en condition d’examen pour vérifier si le candidat est capable d’élaborer le diagnostic de performance énergétique en utilisant une méthodologie adaptée aux cas traités, à en interpréter les résultats et à les restituer à un non-spécialiste
La préparation au passage des examens est réalisée tout au long de la formation.
L’entretien devant le jury de certification, qui a lieu en fin de formation, se déroule en 4 temps :
- Soutenance du mémoire
- Mise en situation partie 1 : Le jury de certification joue le rôle du client dans la mise en situation tirée au sort par le candidat.
- Mise en situation partie 2 : Le candidat expose au jury toutes les incohérences et les erreurs du rapport de diagnostic qui lui a été remis.
- Entretien avec le jury : Le candidat répond aux questions du jury qui porte sur le mémoire, la mise en situation et/ou toute question que le jury estime pertinente faisant partie du référentiel d’activités, de compétences et d’évaluation.
Mise à jour des informations pratiques et du programme de formation au 1er novembre 2024
Taux de présentation et de réussite
Titre professionnel enregistré au RNCP sous le numéro 12300, délivré par K2D Formarseille, avec une date d’échéance de l’enregistrement au 14 octobre 2025
Taux de présentation et de réussite
- Taux de présentation : 100 %
- Taux de réussite : 56 %
Nombre de candidats inscrits : 9
Nombre de candidats présents : 9
Nombre de candidats ayant obtenu le titre professionnel : 5
- Taux de présentation : 100 %
- Taux de réussite : 56 %
Nombre de candidats inscrits : 9
Nombre de candidats présents : 9
Nombre de candidats ayant obtenu le titre professionnel : 5
Taux d’insertion à six mois
Aucune données à ce jour.
Une enquête sera réalisée six mois à compter de la date de formation et la présente section sera alors mise à jour ainsi qu’il suit : « Sur {nombre de} candidats ayant répondu à l’enquête 6 mois à compter de la date de fin de formation, {x} exercent le métier de diagnostiqueur immobilier ce qui représente un taux d’insertion de {x}%.
Mis à jour au 1er novembre 2024